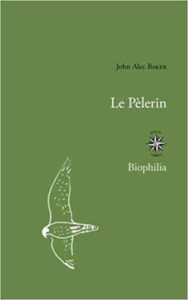«Un œil de faucon femelle pèse à peu près vingt-huit grammes ; il est plus gros et plus lourd que l’œil humain. Si nos yeux avaient cette grosseur par rapport à notre taille, un homme de soixante-seize kilos aurait des yeux longs de 7,5 centimètres, pesant quatre livres.» Un tel portrait n’est pas franchement fidèle aux canons esthétiques dominants, mais quand on aime les oiseaux comme l’écrivain J.A. Baker, fasciné plus précisément par les faucons pèlerins, imaginer une créature humaine dotée des caractéristiques de son animal totem est une preuve supplémentaire de dévotion. Les Egyptiens ont bien inventé le dieu Horus à tête de rapace.
Habitant du comté d’Essex, dans le sud-est de l’Angleterre, John Alec Baker (1926-1987) fit de l’activité bien anglaise du birdwatching le cœur d’une entreprise littéraire : raconter dix ans de traque des faucons dans l’estuaire de la Tamise, resserrés pour les besoins du livre en journal de bord d’un hiver. Publié au Royaume-Uni en 1967, réédité aujourd’hui en France, le Pèlerin est devenu en Grande-Bretagne un livre référence du genre naturaliste, qui le dépasse tant ce voyage immobile dans la froidure offre des descriptions de paysages d’une beauté et d’une précision bouleversantes. Et parce qu’il est le récit d’une ascèse : un homme solitaire se dépouille mentalement pour croiser le regard du féroce oiseau, pénétrer sa psyché, et sentir battre son cœur quand il l’accompagne en imagination dans le vaste ciel de l’estuaire.
«Partagez la peur»
John Alec Baker était myope mais, équipé d’une longue-vue et de jumelles, il est au théâtre, voit tout, pressent les drames : ce ramier à la traîne ne fera pas de vieux os, cet étourneau imprudent vole trop haut, va s’épuiser et n’échappera pas au poignard du pèlerin. Marchant, courant, rampant, pédalant dans les marais, Baker peut suivre pendant des kilomètres un tiercelet, mâle ainsi appelé parce qu’il pèse un tiers de moins que la femelle. Il repère leurs habitudes. Tel rapace au plumage plus sombre revient immanquablement dans le même verger, un autre se repose toujours sur un orme moussu. Il observe leurs jeux aériens par tous les temps, même la tempête, car «le pèlerin sauvage aime le vent, comme la loutre aime l’eau».
Et les oiseaux, que pensent-ils de cet animal étrange à l’affût ? Baker, déposé en voiture par sa femme sur les lieux, parfois avant l’aube, a lui aussi ses rituels. Il conseille : «Pour être reconnu et adopté par un faucon pèlerin, vous devez porter toujours les mêmes vêtements, vous déplacer à la même allure, accomplir vos actes dans le même ordre. Comme tous les oiseaux, il craint l’imprévu. […] Voilez l’éclat de vos yeux, dissimulez la blancheur frémissante de vos mains, tamisez la lumière brutale de votre visage, feignez l’immobilité d’un arbre. […] Apprenez à avoir peur. Partagez la peur, voilà le lien le plus important.»
Au fil de cet hiver, l’ornithologue amateur s’approchera plusieurs fois du pèlerin, l’un ou l’autre de son espèce. Le contact visuel s’établit, les oiseaux sont curieux. «Je dois être maintenant à ses yeux mi-faucon, mi-homme ; quelqu’un qui vaut bien un regard de temps à autre, mais à qui il n’accorde pas encore toute sa confiance. Une sorte de faucon infirme peut-être, incapable de voler ou de tuer comme il faut, de caractère instable et morose.» Peut-être l’oiseau comprend-il l’intérêt d’être suivi par une créature dont la présence fait s’envoler les proies potentielles ? De fait, Baker n’est jamais bredouille. Ses longues heures d’affût sont presque toujours récompensées. Il voit même de loin un pèlerin. Un petit point dans le ciel grandit : ce n’est pas ce qu’il croyait, un vanneau ou une corneille, c’est l’oiseau aux yeux immenses et au bec meurtrier. Parfois il le perd de vue et attend, confiant, son retour. L’auteur sent une contagion d’identité. N’est-il pas «aussi solitaire»que lui ?
Plumes et pierres
Si Baker raconte ses moments de bonheur de chasseur sans fusil, ces mois d’affût ne sont pas une épopée bucolique. L’hiver 1962-1963 est dur, même s’il l’est moins qu’en Scandinavie d’où viennent les faucons qui y retournent en été. Les populations d’oiseaux, alors bien plus nombreuses qu’aujourd’hui, souffrent du froid hivernal, de la faim. Quand les températures chutent, il croise des cadavres à plumes, couchés ou debout, comme ce héron pris dans la glace. C’est la période où le relevé des victimes des faucons, après des piqués à la vitesse phénoménale, fait penser à des scènes de crimes : des plumes, du sang dans la neige et des os nettoyés comme de l’ivoire. Il faut s’habituer à la férocité de l’animal qui vise vanneaux, bécasseaux, canards, ramiers, mouettes… En un après-midi, Baker constate qu’un faucon a pu tuer au moins six oiseaux. Parfois le rapace revient finir les restes et recrache plumes et pierres ingérées pour faciliter la digestion.
Et puis il y a alors la grande menace humaine du DDT. A l’époque où Baker menait ses observations, dans les années 50 et 60, ce pesticide puissant décimait les oiseaux. Quand il écrit son prologue, il pense qu’il est trop tard, que les faucons sont condamnés à la grande rareté ou à disparaître : «Beaucoup d’entre eux meurent, couchés sur le dos, tentant de se raccrocher désespérément au ciel dans leurs dernières convulsions, ravagés et brûlés par l’immonde pollen des traitements chimiques agricoles.» Depuis, le DDT a été interdit en Europe, les pèlerins ont été classés comme espèce protégée. Mais d’autres menaces ont surgi avec le bouleversement du climat planétaire ; le déclin des populations d’oiseaux est aujourd’hui vertigineux. Aussi le Pèlerin fait-il naître un profond sentiment de nostalgie, tant il rend proche ce monde de tiédeur, de jeux aériens, de peur et de cruauté.